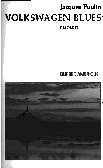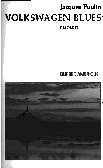|
Volkswagen
Blues:un roman postcolonial québécois
Le roman Volkswagen Blues
a été beaucoup critiqué et étudié par
de nombreux auteurs. Cependant personne ne l'a encore abordé comme
un roman de type postcolonial. Pourtant les thématiques, les formes
et les articulations du texte font un excellent exemple d'écriture
postcoloniale. L'analyse que je me propose de faire se déroulera
exactement à l'image du récit, soit en trois temps. D'abord,
la situation initiale qui provoque l'action, le grand départ et
le voyage vers la Grande aventure et, finalement, la chute. Cette étude
m'amènera à réviser les concepts de métarécits,
de polyphonie et de multiculturalisme afin de souligner le caractère
complexe du discours postcolonial du roman.
Le premier grand prétexte de ce
récit est la quête du grand frère qui n'a pas donné
de nouvelles depuis plus de dix ans. À l'orée de ses quarante
ans, Jack, le personnage principal, aboutit à Gaspé d'où
lui est parvenue la dernière carte postale de Théo. Il pense
et espère y trouver des indices. Il y rencontre plutôt une
jeune métisse qui l'aide dans ses recherches et l'accompagnera dans
sa quête à travers l'Amérique du Nord.
Les détails ont une importance
capitale dans la compréhension de ce roman. Il est donc impératif
de s'arrêter à la fameuse carte postale envoyée par
Théo plusieurs années auparavant. Sur cette carte est imprimé
un texte de Jacques Cartier rapportant l'implantation de la croix à
Gaspé au nom du roi de France. Ce texte, en plus de raconter un
épisode historique, rapelle la colonialisation du territoire par
la France dès 1534. La carte ayant été envoyée
par un amateur d'histoire, le lecteur peut soupçonner tout comme
Pitsémine que Théo avait une intention bien précise
ce jour-là sans pour autant mentionner explicitement laquelle.
Cette carte est certainement l'élément
déclencheur du récit. Mais en dehors de la carte, les caractéristiques
des deux protagonistes servent de bornes permettant de saisir la pensée
du texte et campant les préalables du récit. Jack Waterman
est un écrivain peu connu qui souffre d'insatisfaction professionnelle.
Il n'aime pas ses propres textes et n'aime pas le genre d'écrivain
qu'il est. Sa vie ne correspond pas à son idéal. Sa compagne
de voyage, Pitsémine, est une métisse qu'il prend au auto-stop
et qui accepte difficlement le caractère hybride de son identité.
Tout comme l'homme, elle adore lire et a un point de vue bien particulier
sur les livres.
Les deux complices s'embarquent
donc ensemble vers Saint-Louis afin de découvrir de nouveaux indices
pour retrouver Théo. Ils voyagent dans un véhivule très
spécial, très populaire à l'époque des Hippies,
un vieux minibus Volkswagen. Le vieux Volks a aussi un curriculum vitae
significatif. Avant d'appartenir à Jack, il "avait été
acheté en Allemagne; il avait parcouru l'Europe et traversé
l'Atlantique sur un cargo, ensuite, il avait voyagé le long de
la côte Est, depuis les Provinces Maritimes jusqu'au sud de la Floride",
un peu à la manière de la conquête de l'Amérique.
Avec la quête de Théo, le véhicule etdes passagers
ont traversé tout le continent comme les premiers colons américains.
Par le biais de textes d'inspiration historique, ils remontent le temps
pour revivre toutes les péripéties de leurs prédécesseurs.
Ils font donc le voyage selon deux temps, celui des premiers colons et
le leur, celui de la quête de Théo.
L'histoire et la mémoire
sont au coeurs du récit mais aussi au centre des préoccupations
des deux voyageurs. Ces deux thèmes les accompagneront dans leur
démarche vers l'Autre qui commence véritablement lorsqu'il
quittent Québec vers Saint-Louis au Missouri et traversent la frontière
américaine. Tant au point de vue du récit qu'au point de
vue du discours, les thèmes et les formes conduisent à l'élaboration
d'un texte potcolonial. J'essaierai donc deprésenter les caractéristiques
de manière parrallèle.
Afin de faciliter la compréhension
des différentes facettes postcoloniales de ce roman, j'aborderai
la partie "voyage" des deux protagonistes selon trois thèmes
majeurs reconnus dans la littérature postcoloniale soit la pénétration
du territoire de l'Autre, l'incidence de la lecture et de l'écriture
sur l'évolution du périple et mes multiples quêtes
imbriquées lesune dans les autres qui souligne l'influence de l'altérité
sur le développement intérieur des personnages.
L'entreprise de Pitsémine et
Jack, en partant pour le Missouri, est bien plus riche en conséquences
et en significations que le simple désir de retrouver Théo.
Les deux compères quittent Québec vers les États-Unis
en ne sachant pas s'ils vont retrouver Théo à Saint-Louis.
C'est une forme de conquête d'un territoire inconnu doublée
d'une chasse au trésor comparable à celles des épices
tant convoitées au temps de Cartier.
Ils ne trouvent pas Théo à
Saint-Louis mais tombent sur un filon qui pourrait bien les mener à
lui et ce, en empruntant la Piste de l'Oregon. Mais ce périple
à travers l'Amérique est aussi un prétexte à
l'élaboration d'un décor où les personnages sont
confrontés à l'altértié. Ils sont tous les
deux francophones et leur anglais est déficient. Le récit
rapporte peu d'occasion durant lesquelles les protagonistes sont amenés
à s'exprimer dans la langue de l'Autre pour être compris.
En fait, la majorité des échanges importants pour leur quête
se font en français avec des gens d'origine québécoise
ou ayant eu, par le passé, des liens à la France ou au Québec.
En outre, la communication avec l'Autre
dans la langue de l'Autre est souvent avortée dans ce roman. À
la frontière américaine, Jack est questionné par
les douaniers de manière peu aimable. Il finit d'ailleurs par s'enquérir
des motifs qui le font pressentir comme suspect et si son métier
d'écrivain en était la cause. "No. Because you don't
seem to know anything." Ainsi le premier contact avec
l'Autre en est un de réglementation et de pouvoir dans lequel l'Autre
fait sentir son autorité et son droit d'expulser l'étranger.
S'ils partaient à la conquête d'un territoire en conquérant,
leur esprit glorieux a été bien vite réprimé.
Puis, comme si cet accueil glacial
n'était pas suffisant, la ville de Détroit, première
escale en territoire de l'Autre, devient menaçante dès le
coucher du soleil."This is rough town. You don't go out on the street
after sunset." L'apprentissage du territoire d'autrui se fait dans
la crainte. Un climat d'inquiétude que Jack et Pitsémine
ne soupçonnaient pas avant et qui leur donne une bien mauvaise
impression du territoire exploré. L'Autre n'est pas seulement étranger,
il peut également être dangereux et inspire la méfiance.
Ils furent accueillis de manière
plus chaleureuse à Chimney Pock où Pitsémine espérait
avoir des indices sur Théo. Ils y rencontrèrent la femme
d'un bull rider qui avait connu Théo quelques années
auparavnt. Elle trouvait d'ailleurs un air de ressemblance entre lesdeux
frères et semblait avoir pour le souvenir de Théo une certaine
tendresse. La femme leur apprit que Théo avait à l'époque
l'intention de poursuivre son chemin sur la Piste de l'Oregon jusqu'à
l'embranchement menant d'un côté en Oregon et de l'autre
en Californie.
Plus tard, après avoir traversé
une longue région désertique, les deux explorateurs ont
eu envie d'expérimenter l'accueil chaleureux et légendaire
des habitants du far west. "Ils décidèrent de
mener une expédition pour parler à quelqu'un". Avant
d'être arrive sur le ranch, ils s'imaginent leur accueil selon les
meilleurs films western faisant éloge des moeurs cordiaux. "Il
paraît que les gens sont très hospitaliers dans l'Ouest.
J'ai lu ça dans la documentation du Nevada."
Au début du récit, Jack avoue à Pitsémine
que tout ce qu'il sait, il l'a appris dans les livre. L'excursion sur
un ranch n'a pourtant rien à voir avec ce que disait leguide touristique
du Nevada.
En effet, ils ont croisé à
l'entrée du domaine un écriteau qui disait: NO TRESPASSING.
Ils ont rit du jeu de mots avec"défendu de trépasser"
alors qu'ils auraient mieux fait de suivre l'indication puisqu'ils ont
été accueillis par "trois chiens, la gueule baveuse,
les babines retroussées et les crocs menaçants(...)."
Les deux acolytes sont donc repartis,troublés. Jack a même
fait un lapsus plein d'ironie:"(...)les gens se sont pas tous des
chiens". Leur mouvement vers l'Autre n'a pas été un
succès. En réalité, la connaissance de l'Autre dans
le récit n'est pas simple et le chemin qui mène à
la communication est parsemé d'embûches. L'hôte américain
n'accueille pas les deux voyageurs à bras ouverts, exception faite
de la femme du bull rider, et seuls les personnages francophones
aident à la recherche de Théo. L'expérience de Jack
et Pitsémine est rude et les confronte à un passé
historique violent dans une contrée peu hospitalière. Leur
voyage se fait dans un cadre restreint où ils fréquentent
peu les habitants des régions traversées. Chaque mouvement
vers l'Autre résulte souvent en un rejet et une incompréhension
mutuelle.
Anne Marie Miraglia soutient que "les
protagonistes pouliniens peuvent bien prendre la route des États-Unis,
mais ils ne le font pas dans le but demieux connaître leurs voisins
américians. Dans Volkswagen Blues, le voyage aux États-Unis
vise une Amérique française et implique un émigré
canadien-français, que celui-ci prenne la forme de Théo/Kerouac,
du coureur de bois du XVIIIe ou de l'émigré des XIXe et
XXe siècles." Il est alors révélateur que les
personnages guides parlent tous français, bien que ce dernier ne
soit pas fluide.
Il n'en demeure pas moins que cette
pénétration du territoire de l'Autre se fait conjointement
avec la prise de conscience de l'existence d'une vision différente
de la vie, de moeurs différents et d'un langage étranger.
Les personnages sont confrontés à cette différence
et doivent composer avec celle-ci. L'univers langagier est en fait, le
principal contact avec l'Autre. Le langage, un des thèmes centraux
du discours postcolonial, devient alors un outil de conquête et
de différenciation.
Le langage est un thème récurrent
chez Jacques Poulin et ce roman, sans en traiter de manière aussi
manifeste que Les Grandes Marées, met plutôt l'accent
sur les anglicismes et les interprétations sémantiques de
termes anglais. Il est important de relever la présence répétée
de termes et d'expressionn anglaises dans le texte. Ces expressions n'ont
jamais de traduction puisque la compréhension du lexique utilisé
fait partie de l'horizon d'attente du lecteur. Une des particularités
du texte postcolonial est que ce dernier allie l'emploi d'un vocabulaire
étranger à différents jeux de mots pour multiplier
les sens et les jeux de significations. Ce roman par son récit
au coeur de l'Amérique jouit d'un cadre spatial et linguistique
parfait pour l'introduction de plusieurs jeux de langage utilisant parfois
le français mais surtout l'anglais ou l'américain.
Les protagonistes créent entre
eux une forme de langage secret où certains mots français
ou anglais prennent un sens nouveau et compris d'eux seuls. Selon Bakhtine,
un mot peut avoir un sens modifié selon une entente entre les interlocuteurs,
voire entre les membres d'une collectivité plus étendue.
C'est le cas pour le terme "emprunter"qu'utilise Pitsémine
lorsqu'elle subtilise un livre dans une bibliothèque. "Quand
il s'agissait de se procurer un livre, elle faisait une distinction entre
les librairies et les bibliothèques. Dans les librairies, elle
volait les livres sans aucun scrupule, car elle trouvait que laplupart
des libraires aimaient plus l'argent que les livres." Dans les bibliothèques,
elle les "emprunte" et les retourne par la poste ensuite avec
un mot disant qu'elle avait trouvé ce livre dans une toilette,
etc. Ainsi, dans cet exemple, le verbe "emprunter" revêt
un sens nouveau et crée une complicité entre Jack et Pitsémine.
La présence des mots de l'Autre
dans le discours, dans ce cas l'anglais, sert à renforcer l'atmosphère
d'étrangeté et de dépaysement des personnages. Outre
les extraits de conversations anglaises non traduites, le récit
renferme des expressions typiquement américaines qui prennent pour
les deux voyageurs un sens privilégié mais distinct de l'original.
"(...)elle n'aimait pas l'expression française "accotement
mou", mais chaque fois qu'elle voyait Soft shoulder, elle
pensait à toutes sortes de choses agréables: la douceur
d'une épaule, un endroit où reposer sa tête (...)"
Le texte joue sur le sens de l'expression en mettant en parallèle
la véritable signification du terme et l'interprétation
romancée de la fille qui colle aux mots dans une traduction malhabile
de "douce épaule".
Jack utilise aussi cette méthode
d'interprétation qui traduit mot à mot les expressions anglaises
et crée une traduction amusante. L'inscription lue à haute
voix par Jack et aussitôt révisée, NO TRESPASSING,
devient une interdiction de mourir ou de trépasser. Ironique lorsqu'on
se rapelle qu'ils ont été accueillis par des chiens enragés
prêts à les dévorer. Ces deux exemples démontrent
que le langage de l'Autre inspire les passagers du vieux Volks vers la
romance ou l' insouciante témérité. Mais ce qui est
remarquable, c'est qu'ils adoptent toujours une signification imaginaire
du terme anglais. Ils s'appropient les termes de l'Autre pour en redéfinir
le sens. Sur le territoire de l'Autre, ils révisent leur vision
de celui-ci, prennet possession du langage et s'ouvrent à de nouvelles
possiblités d'existence, de pensée et d'expression. Ils
n'utilisent pas le langage pour mieux comprendre autrui, ils créent
une langue à part ,de deuxième niveau, dont eux seuls ont
l'intelligence et qui les coupent du monde et, dans ce roman, de l'Autre
américain.
Ce périple à travers l'Amérique
se fait évidemment au rythme de leurs trouvailles et des indices
les menant à Théo. Mais il permet aussi un voyage dans le
temps en suivant la Piste de l'Oregon et les amène à partager
leurs points de vue sur les événements historiques. Pitsémine,
par sa connaissance de l'histoire des Amérindiens et des forts
militaires, entraîne Jack dans une remise en question des discours
enseignés et des faits racontés sur cette période
de colonisation ou d'appropriation du grand territoire américain.
Jack remet en question les métarécits dont parle Lyotard
car il questionne ses connaissances de l'histoire et la version diffusée.
Cette révision de l'histoire américaine s'ajoute aux caractérisiques
postcoloniales du roman en impliquant la figure de l'Autre dans l'élaboration
de ce questionnement mnémonique.
| La revision de l'histoire |
Les deux personnages, par leurs identités
différentes, peuvent comparer leurs deux visions du monde selon
des principes et des idéaux dissemblables. En fait, les deux amis
confrontent leur altérité distincte. Pitsémine est
celle qui remet toute l'histoire de l'Amérique en question. Cela
pousse Jack à lire aussi sur le sujet. La perception de Jack en
sera fort ébranlée. "On commence à lire l'histoire
de l'Amérique et il y a de la violence partout. On dirait que toute
l'Amérique a été construit sur la violence."
De son côté, la jeune femme
raconte la colonisation du territoire avant l'arrivée des Blancs,
c'est-à-dire selon les traditions amérindiennes et àl'époque
de la chasse aux bisons. Elle raconte à son compagnon tous les
charmes de la vie selon le respect de la nature. Elle parle des grands
guerriers des différentes tribus ,mais elle parle également
de leur extermination par les Blancs. Jack finit par s'habituer à
ses sorties contre les Blancs et contre les militaires. L'épisode
au musée du Fort Laramie où Pitsémine hurle contre
une arme automatique illustre d'ailleurs à quel point elle se sent
impliquée dans le pasé amérindien de l'Amérique
du Nord. Pitsémine prend toute l'histoirede ces peuples à
coeur parce qu'elle est de sang mêlé et se sent partagée
entre les cultures amérindiennes et occidentales. Pourtant, elle
adopte dans ses narrations la seule optique amérindienne bien qu'elle
soit en partie québécoise aussi.
Effectivement, elle raconte tous les
événements historiques selon sa vision, celle de l'oprimé,
celle de l'Améridien chassé de son territoire ancestral
par les nouveaux venus, les Blancs. Jack veut également partatger
sa passion et ses connaissances du passé en parlant de ses héros,
des héros tellement assosiés à Théo qu'ils
en sont une véritable personnification. Mais ces derniers ne gardent
pas longtemps leur statut puisque leur caractère et leurs erreurs
du pasé sont cernées par la jeune métisse, de sorte
que les fameux héros deviennent déchus même aux yeux
de Jack. C'est le cas d'Éteinne Brûlé contre qui le
gardien de sécurité de la bibliothèque de Toronto
prononça la première sentence. " Je pense qu'Étienne
Brûlé était une bum." Puis, dans un livre
que lisait Pitsémine, l'auteur non plus ne semblait pas avoir une
très haute opinion du fameux coureur desbois qui passait pour un
traître à la nation. La jeune lectrice finit par toucher
le point sensible de Jack. "C'est pas Étienne Brûlé
que vous cherchez à défendre, c'est votre frère Théo.
Vous avez peur que votre frère ait fait quelque chose de mal...mais
comme cette idée vous déplaît, vous la refoulez dans
votre inconscient et, au lieu de défendre la conduite de votre
frère, vous défendez celle d'Étienne Brûlé."
En fait, Jack associe gauchement Théo et ses héros d'enfance.
Ceux-ci deviennent ensemble une forme d'être supérieur que
l'écrivain voudrait intouchable, comme il se représente
son frère.
L'histoire des Blancs se modifie dans
la pensée de Jack,bien qu'il garde secrètement l'espoir
que tout ne soit pas un mirage. "C'était comme si tous les
rêves étaient encore possibles. Et pour Jack, dans le plus
grand secret de son coeur, c'était comme si tous les héros
du passé étaient encore des héros." Lavision
de l'histoire s'est modifiée pour Jack et pour Pitsémine
parce qu'ensemble ils s'influencent et réalisent certaines erreurs
de perception. La pensée colonisatrice que représente l'écrivain
est confrontée à celle du colonisé que défend
Pitsémine afin de se pencher sur l'histoire enseignée qui
est souvent celle qui favorise le colonisateur. La révision de
l'histoire permet ainsi une compréhension toute en nuance du passé.
Ce faisant, le roman, en tant que texte postcolonial, abat les barrières
des dogmes historiques imposés par le colonisateur et invite le
lecteur à s'interroger face aux événements réels.
Au sein de leur aventure dans le passé,
les deux personnages s'accompagnent d'outil de référence
qui parlent autant de la pénétration du continent par les
premiers colons que de l'histoire des Amérindiens et des tribus
décimées. En fait, chacun lit etraconte ensuite ses lectures
à l'autre. Pitsémine a une mémoire extraordinaire
des faits et des dates, elle raconte donc plusieurs moments de l'histoire
despeuples autochtones et apporte aussi un nouveau point de vue sur l'histoire.
Par exemple, elle raconte à son
partenaire l'histoire des Illinois du Rocher, une tribu disparue, exterminée
par une autre. Cette histoire est une légende peu connue qui vient
compléter la culture de Jack. Pitsémine raconte aussi la
chasse aux bisons des Amérindiens dont elle n'approuvait pas toutes
les méthodes tout en les comparant ensuite à celles des
grands chasseurs européens tels que Buffalo Bill ou le grand-duc
Alexis de Russie.
Ainsi, ils voyagent en compagnie de
différents écrits que Anne Marie Miraglia a répertoriés
selon un dédoublement à la fois géographique, historique
et littéraire. Il y a, effectivement, neuf textes historiques qui
influencent le déroulement du discours de ce roman. Les multiples
références aux intertextes historiques mettent en parallèle
trois voyages d'exploration du continent américain. Il y a d'abord
le voyage de Pitsémine et de Jack en quête de Théo,
il ya également celui des premiers pionniers du XIXe siècle
qui cherchaient la terre du bonheur, puis il y a celui de Jacques Cartier
et des autres explorateurs français du XVIe siècle qui sont
venus découvrir le territoire.
Cependant, il y a deux textes qui viendront
plus particulièrement alimenter le discours et l'imaginaire de
Volkswagen Blues. D'abors,il y a The Oregon Trail Revisited,
de Gregory M. Franzwa, une forme de réécrituree d'un journal
tenu par le pionnier Francis Parkman et publié en 1847. Il y a
ensuite On the Road, le fameux roman de Jack Kerouac, l'idole de
Jack Waterman. Les deux écrits sont des ouvrages en possession
de Théo lors de son arrestation à Toronto. Ces deux ouvrages
leur livrent des indices sur le parcours de Théo et sur la pensée
des explorateurs du continent. Ce récit devient même au centre
du récit de Poulin à partir du chapitre 19, intitulé
"Mourir avec ses rêves". En effet, la lecture et la narration
de récit des explorateurs suit le parcours des protagonistes le
long de la vieille piste des pionniers. Le rêve d'un monde nouveau
des pionniers se dédouble avec celui de Jack et Pitsémine
de retrouver Théo, et aussi, de se trouver eux-mêmes. Le
thème du rêve prend donc une place bien spécifique
dans le déroulement de la narration.
Les deux personnages commencent, à
ce moment-là, leur véritable introspection. Plus tôt,
Pitsémine expliquait justement toute l'importance du rêve
dans une réflexion personnelle. "Les rêves sont comme
des îles. Alors on est tout seul quand on rêve et ça
ne peut être autrement." Les récits qu'ils font les
poussent à se remettre en question en tant qu'écrivain et
en tant que métisse.
L'intertexte
du roman de Jack Kérouac vient appuyer cette quête d'identité personnelle
des deux protagonistes. "On the Road est un des textes qui
incite l'auteur québécois Jack Waterman, à prendre la route. Avec Volkswagen
Blues, l'œuvre poulinienne franchit les murs du Québec et explore
l'Amérique ; la quête du frère ne vise pas tout simplement les rapports
humains en Amérique mais, en particulier, les rapports du Québécois avec
le Canadien français exilé aux États-Unis ainsi que l'exploration de son
américanité, de son appartenance au continent nord-américain : ce voyage
à travers l'espace américain rapprochera Jack Waterman de son frère Théo,
de son enfance et d'une Amérique d'origine française." Anne Marie
Miraglia exprime bien l'incidence du roman kerouacien sur l'action de
Volkswagen Blues. "L'esprit de On the Road, son génie pour l'aventure,
le risque, le voyage, soutiennent la quête de Théo, un émule de Jack Kerouac,
coureur de bois moderne. " En effet, Jack Kerouac est une figure emblématique
pour le protagoniste écrivain. Cet auteur allie toutes les qualités que
recherche Jack comme écrivain tout en ayant également la bravoure qu'il
impute à son grand frère. Autant dans sa quête personnelle que dans son
obsession de l'écrit, Waterman alloue une grande place à cet auteur de
plusieurs romans d'aventure. L'écriture est au cœur des conflits intérieurs
de Jack, elle représente une grande partie de lui-même. Elle jouera donc
un rôle important dans l'introspection de Jack que j'étudierai plus loin
sous la thématique identitaire si importante dans les écrits postcoloniaux
et qui se résout sous le joug de l'altérité.
Mais
d'abord, je soulignerai toute la puissance de la figure de l'écrit et
de la lecture dans ce roman; des figures permettant l'élaboration d'un
discours autoréférentiel trahissant la matérialité du texte qui s'ajoute
au contrat postcolonial de repousser les frontières de la tradition littéraire
sans néanmoins les transgresser.
Les
lectures des deux personnages les accompagnent au cours du voyage à travers
l'Amérique mais aussi au cours de leur voyage intérieur où ils apprennent
à mieux se connaître et à s'identifier. Ainsi que je le mentionnais, les
écrits de Kerouac sont une forme de reflet du discours de Volkswagen Blues
tout en établissant avec le personnage Jack une comparaison d'idéalisme.
En effet, Jack a une vision très claire de l'écrivain idéal.
Il
n'aime pas sa propre façon de travailler. "Il se rangeait parmi ceux qu'il
appelait "l'espèce laborieuse" : patient et obstiné mais dépourvu d'inspiration
ou même d'impulsions […]. " Pour lui, l'écrivain idéal c'est celui qui
est surpris par une idée, une idée qui s'impose et qui grandit, se développe
et l'envahit, de sorte que l'écrivain n'a d'autre choix que de l'écrire,
de la laisser s'épanouir jusqu'à l'épuisement de ses forces alors que
le texte est achevé et que lui, il a tout livré sur papier dans un chef-d'œuvre
littéraire. Le roman décrit une scène très dramatique de la vision de
Jack qui laisse l'écrivain idéal complètement épuisé après l'écriture
de son ouvrage.
L'écriture,
je le répète, est au cœur des préoccupations et des insatisfactions personnelles
de Jack. Ainsi, il n'est jamais satisfait de ses propres romans dont la
première phrase est banale et n'a rien de l'idéal qu'il s'est fixé. "La
première phrase, selon lui, devait toujours être une invitation à laquelle
personne ne peut résister¾une porte ouverte sur un jardin, le sourire
d'une femme dans une ville étrangère. " L'Auteur dans les Grandes Marées,
qui travaille à la première phrase de son roman, a la même opinion : Ça
ne sert à rien d'aller plus loin si la première phrase n'est pas parfaite.
" Jack accorde un pouvoir certain à l'écrit, celui de dépayser le lecteur,
de le transporter dans un autre monde. Puis, à l'instar de Teddy, les
livres ont aussi une valeur précieuse pour l'écrivain. Ses livres préférés
sont pour lui comme de vieux amis qu'il relit souvent entre l'écriture
de deux romans. Il parle même de cette période d'angoisse où entre deux
créations l'auteur se met à douter de son talent et à remarquer toutes
les faiblesses du texte à peine achevé.
L'écriture
est pour Jack bien plus qu'un moyen de communication, c'est "plutôt une
forme d'exploration. "Il lui accorde cependant une valeur communicative.
Il n'y a de meilleurs exemples que la carte de Théo. En effet, Jack pense
que peut-être celle-ci était porteuse d'un message important de son frère
et qu'il était peut-être alors si pris lui-même dans un roman qu'il n'avait
rien vu. La carte postale que son frère lui avait envoyée de Gaspé était
une sorte d'appel au secours, un signal de détresse. Mais il n'avait pas
compris et ce, pour deux raisons : premièrement, à cette époque il était
occupé à écrire un roman, ce qui l'empêchait d'être attentif à ce qui
se passait autour de lui ; deuxièmement, Théo avait rendu le message difficile
à déchiffrer[…]. L'écriture le coupe du monde comme la traduction le faisait
pour Teddy dans Les Grandes Marées.
L'écriture
est aussi un phénomène puissant aux yeux de la fille. Pitsémine considère,
en effet, que l'expression une image vaut mille mots est erronée. Selon
elle, un mot vaut mille images. Il y a dans chaque mot plus de sens contenu
et de rapprochements possibles que dans l'agencement des figures d'une
image complète. Cette position se rapproche de la pensée de Mikhaïl Bakhtine.
En effet, cette perspective assimile à la fois une partie des la notions
de plurinliguisme et d'intertextualité. Ainsi, un mot peut s'interpréter
sous plusieurs angles et produire des rapprochements de sens multipliés
d'où son expression un mot vaut mille images.
En
fait, la jeune femme a une vision dialogique de la lecture et jusqu'à
un certain point de l'écriture aussi, croyant à une lecture rapprochant
autant les intertextes cités dans le texte que les intertextes provenant
de la culture générale du lecteur communément appelé l'horizon d'attente.
Il ne faut pas juger les livres un par un. Je veux dire : il ne faut pas
les voir comme des choses indépendantes. Un livre n'est jamais complet
en lui-même; si on veut le comprendre, il faut le mettre en rapport avec
d'autres livres, non seulement avec les livres du même auteur, mais aussi
avec des livres écrits par d'autres personnes. Ce que l'on croit être
un livre n'est la plupart du temps qu'une partie d'un autre livre plus
vaste auquel plusieurs auteurs ont collaboré sans le savoir. Pitsémine
croit également en l'utilité de la relecture d'un texte. Au contraire
de Jack qui préfère garder intact le premier contact à un livre, elle
pense qu'une meilleure compréhension nécessite de lire plusieurs fois
le même ouvrage. "Qui n'a pas relu, n'a pas lu. " La jeune mécanicienne
est une lectrice vorace qui lit beaucoup. Elle croit dans le pouvoir des
mots et d'une lecture en profondeur que permet la relecture des écrits.
Le roman Volkswagen Blues allie dans ses personnages un idéal d'écriture
et de lecture. En fait, il semble possible que les personnages représentent
la vision auctoriale des deux composantes de la création littéraire. J'irais
jusqu'à dire que ce roman complète avec raffinement l'idéal de Jacques
Poulin esquissé dans Les Grandes Marées.
L'auteur présente par le biais de l'autoréférentialité sa vision de l'écrivain
et sa vision du lecteur parfait. En me permettant un rappel du roman analysé
précédemment, il est clair que les particularités excessives de minutie
et de perfection chez Teddy faisant de lui un excellent traducteur qui
démontrait énormément de professionnalisme. Marie est, dans ce roman,
la lectrice qui savoure ses lectures de manière à pouvoir les mémoriser,
faisant ainsi de ces parties de textes autant d'histoires à raconter comme
des métarécits ou des mises en abîme intertextuels.
Le
roman Volkswagen Blues présente des personnages plus posés qui affirment
leurs idéaux de lecture et d'écriture inscrivant ainsi la pensée de l'auteur
dans le discours. En faisant la synthèse des différents indices décelés
dans le texte, l'image de l'écrivain idéal est explicite selon le scénario
construit par Waterman à ce sujet. L'écrivain idéal ressemble à Jack Kerouac.
Pour le protagoniste, ce type d'écrivain est valorisé sur celui auquel
il appartient lui-même et surnommé, selon ses termes, "l'espèce laborieuse",
un type d'écrivain qui produit sa page quotidienne mais ne peut créer
un œuvre en quelques jours sous l'impulsion créatrice comme Kerouac l'a
fait pour certains romans.
Le
personnage lecteur de ce récit, Pitsémine, valorise une lecture en profondeur
qui alloue plein pouvoir aux mots et qui comprend l'écriture et la lecture
de manière dialogique. L'auteur donne donc des indices à son lecteur afin
que la lecture de son propre récit se fasse selon cette recette. Par le
biais de ses personnages fictifs, Jacques Poulin encourage son lectorat
à tenir compte des intertextes et à confronter ses lectures passées au
roman en cours.
L'autoréférentialité
de ce dernier roman repousse les limites de l'illusion référentielle encore
plus loin, jusqu'à les faire éclater puisque le discours incite le lecteur
réel à adopter une lecture particulière. L'autoreprésentation marquée
du roman positionne le lecteur réel dans un contexte singulier où le discours
sort de son cadre matériel pour lui faire modifier son comportement original
de lecture. Le roman Volkswagen Blues répond ainsi au propre du texte
postcolonial qui remanie la tradition littéraire pour lui apporter une
dimension nouvelle et ouverte sur le monde.
Volkswagen
Blues s'inscrit non seulement par la forte incidence de thématiques comme
la révision de l'histoire, l'intertextualité ou l'autoréférentialité du
discours, mais aussi par la présence soulignée de la quête chez les protagonistes
du récit. Il est notoire que la figure de l'altérité s'insère dans la
compréhension des multiples facettes du discours. L'altérité joue un rôle
de premier rang dans l'analyse des quatre principales quêtes du récit.
La quête initiatrice du récit et de l'aventure de Jack et Pitsémine est
bien sûr celle du grand frère. La première étape de mon analyse se porte
sur la signification du nom du frère, Théo. Théo est un dérivé de theos
en grec qui signifie dieu. Je ne soutiens pas que le personnage de Jack
est à la recherche de Dieu lorsqu'il recherche son frère. La signification
du nom du frère est à mon sens plus révélatrice de la perception qu'a
de ce dernier le protagoniste du texte. Effectivement, Jack idolâtre son
frère à l'image de tous ses héros d'enfance. Je rappelle comme exemple
la défense d'Étienne Brûlé dont j'ai traité précédemment. Théo est un
héros, une légende quasi divine dans le cœur de Jack, d'où l'intérêt du
nom du frère.
Le récit parle justement de la propension de Jack à exagérer les exploits
de son frère afin d'en faire un personnage de légende qui impressionnerait
Pitsémine. Les faits réels ne suffisent pas à dorer l'image de Théo car
"tout cela ne tenait pas le coup, alors il en rajoutait." Puis, à force
de valoriser son grand frère, Jack ressent le besoin d'être considéré
à son tour comme si Théo prenait toute la place. Je suis un champion,
moi aussi. Je suis un champion quand il s'agit de me réveiller en pleine
nuit, de trouver mes vieilles pantoufles avec le bout de mes pieds, de
me rendre à la cuisine dans l'obscurité la plus complète et de me préparer
un chocolat chaud SANS MÊME ALLUMER LA LUMIÈRE DU POÊLE.
Cette
surévaluation du personnage de Théo révèle, tout comme l'idéal de l'écrivain,
une quête d'absolu chez Jack, une quête comparable au grand rêve américain
des premiers explorateurs du continent. "Ce que Jack Waterman admire chez
son frère, c'est son américanité, c'est-à-dire sa disponibilité, sa vivacité,
sa confiance ¾ traits propres aux hommes qui ouvrirent l'Amérique et que
Jack Waterman, solitaire timide, ne retrouve pas en lui-même." Ce besoin
de perfection dans l'image de son frère témoigne également d'un désir
personnel de réalisation chez l'écrivain. Une forme d'identification par
alliance à l'héroïsme d'un Théo devenu mythique.
Jack
s'explique à ce sujet lorsqu'il raconte ses réflexions personnelles à
sa compagne de voyage qui entame alors sa propre introspection. "Mon frère
Théo, je ne l'ai pas vu depuis une vingtaine d'années, alors il est à
moitié vrai et à moitié inventé. Et s'il y avait une autre moitié… La
troisième moitié serait moi-même, c'est-à-dire la partie de moi-même qui
a oublié de vivre. " Ainsi Théo est simultanément un amalgame des souhaits
des rêves et des idéaux de son cadet.
La
première quête est donc intimement liée à la quête personnelle et identitaire
de l'écrivain Jack Waterman. D'ailleurs, le romancier justifie la recherche
tardive et nébuleuse de son frère par les prémisses d'un retour sur lui-même
comme une mise au point égocentrique. "J'ai eu 40 ans la semaine dernière
et… Mais non, c'est pas une question d'âge… Il y a des jours où vous avez
l'impression que tout s'écroule… en vous et autour de vous. Alors vous
vous demandez à quoi vous raccrocher… J'ai pensé à mon frère. " Théo devient
une sorte de phare permettant à son frère de faire le point sur ses origines
intimes et de se retrouver.
Comme le souligne Anne Marie Miraglia, la quête du frère est associée
au grand rêve américain et, également, à la recherche du bonheur. Ces
deux thématiques réunissent des thèmes plus particuliers comme l'enfance,
l'Amérique francophone et la découverte d'une américanité. Par conséquent,
la recherche de son frère engendre chez Jack une quête individuelle qui
s'initialise par des souvenirs d'enfance communs et par la rencontre d'écrits
historiques remettant en question ses propres croyances. La quête de Théo
se déroule conjointement dans le temps et l'espace tout en y joignant
la dimension intérieure de l'introspection. Miraglia insiste sur la considération
que "le texte semble indiquer que la quête du frère symbolise également
l'exploration et la découverte de cette partie de soi-même qui est américaine."
La
remise en question de Jack Waterman est autant professionnelle qu'affective
puisqu'il avoue à Pitsémine que l'écriture l'a coupé du monde. Premièrement,
à l'âge où les gens commencent à vivre pour vrai, je me suis mis à écrire
et j'ai toujours continué et, pendant ce temps, la vie a continué elle
aussi. Il y a des gens qui disent que l'écriture est une façon de vivre;
moi, je pense que c'est aussi une façon de ne pas vivre. Je veux dire
: vous vous enfermez dans un livre, dans une histoire, et vous ne faites
pas très attention à ce qui se passe autour de vous et un beau jour la
personne que vous aimez le plus au monde s'en va avec quelqu'un dont vous
n'avez même pas entendu parler. Jack ajoute ensuite qu'il croit n'avoir
jamais aimé personne et qu'il ne s'aime pas lui-même. Pitsémine lui demande
s'il aime ses livres et il répond par la négative puisque ces derniers
ne changent pas le monde ce qui, pour lui, est une nécessité.
La quête de Jack l'amène à apprivoiser le caractère hybride de la situation
de l'écrivain québécois qui est à mi-chemin entre la culture française
de ses ancêtres colonisateurs et celle de ses voisins américains. C'est
pour cette raison que Miraglia parle d'apprentissage de l'américanité
dans ce roman. L'américanité qui semble, à la fois, recherchée et crainte.
En effet, si le thème fait éloge du rêve de la terre promise, il inclut
aussi la violence et l'immoralité du territoire découvert.
Jack, durant son voyage à travers l'Amérique, révise ses opinions et,
par conséquent, change. Lorsqu'il rencontre Théo, un vieil homme déchu
qui a oublié langue, famille et patrie, l'écrivain réalise que son frère
ne peut l'aider dans sa démarche identitaire. Théo a perdu la mémoire
et, du fait, son identité profonde. "La perte de ses capacités mnémoniques
est ici révélatrice, dans la mesure où la mémoire est traditionnellement
garante de la survivance culturelle du Québec dont la devise est, par
ailleurs, "Je me souviens". " L'état de Théo décide alors Jack à retourner
au Québec. Il a été durement confronté à son américanité sans, pourtant,
avoir choisi de l'adopter comme mode de vie, les résultats néfastes chez
son frère aîné lui ayant montré les risques d'une telle abnégation culturelle.
Il laisse le vieux Volks aux bons soins de Pitsémine qui continuera son
chemin dans ce véhicule correspondant bien à son propre nomadisme.
La
quête identitaire de la jeune métisse se fait parallèlement à celle de
Jack durant leur périple. En fait, le questionnement personnel de Pitsémine
pousse Jack à s'interroger plus avant sur ses origines historiques et
sur les fondements de sa culture. Pitsémine affiche, dès leur première
rencontre, une dualité identitaire et culturelle à l'image de sa situation
sociale d'exclue. Elle était venue au monde dans une roulotte parce que
sa mère, en épousant un Blanc, avait perdu la maison qu'elle possédait
sur la réserve de La Romaine; elle avait été expulsée et elle avait perdu
son statut d'Indienne. Mais les Blancs, de leur côté, la considéraient
toujours comme une Indienne et ils avaient refusé de louer ou de vendre
une maison aux nouveaux mariés. Finalement, ses parents avaient acheté
une roulotte.
De
manière générale, Pitsémine a tendance à adopter et à défendre le point
de vue des Amérindiens. Malgré son caractère métisse, elle adhère à la
pensée amérindienne. "Moi, je n'ai rien en commun avec les gens qui sont
venus chercher de l'or et des épices et un passage vers l'orient. Je suis
du côté de ceux qui se sont fait voler leurs terres et leur façon de vivre.
" Pourtant, peu à peu, la jeune femme avoue son état incertain qui la
fait souffrir. En admirant la ville de Saint-Louis toute illuminée la
nuit, elle admet aimer la nature mais aimer aussi certains aspects de
la modernité occidentale. "Je suis partagée entre les deux et je sais
que ça va durer toujours."
En
plus de sa condition hybride, la jeune métisse pratique un métier peu
commun chez les femmes selon les préjugés sexistes ou les standards traditionnels.
Elle est mécanicienne et c'est à elle qu'incombe de vérifier l'état du
vieux véhicule allant jusqu'à nettoyer le filtre de la pompe à essence.
Cette anecdote, en plus de susciter chez Jack des écarts de langage, déclarant
"que la mécanique était la science de l'avenir et qu'elle était plus importante
que la littérature et la philosophie ", met aussi en comparaison le côté
"peu viril" de Jack qui n'y connaît rien en mécanique et la débrouillardise
d'une fille de camionneur.
Ces différentes considérations témoignent du caractère peu traditionnel
du personnage de Pitsémine. Sa situation particulière justifie des actions
radicales et osées ayant pour ultime objectif de la réconcilier avec elle-même,
de lui permettre de s'assimiler à une seule culture. Pitsémine pense que
dormir dans le cimetière de Brandford près du tombeau du vieux chef Thayenganega
l'aidera à mieux se situer face à ses origines amérindiennes. Ce cérémonial
a été une triste déception pour la jeune femme puisqu'elle a réalisé qu'elle
avait perdu confiance dans le chef et qu'il ne pouvait satisfaire ses
exigences.
Son
identité nébuleuse la fait souffrir car elle ne peut s'identifier à aucune
culture, blanche ou amérindienne, en totalité. Pour Pitsémine, cette dualité
se traduit par une absente d'identité. Jack a pourtant trouvé les mots
justes pour consoler la jeune métisse tout en valorisant l'originalité
de sa situation. "Je trouve que vous êtes quelque chose de neuf, quelque
chose qui commence. Vous êtes quelque chose qui ne s'est encore jamais
vu."
La
ville de San Francisco semble être le lieu de prédilection des mélanges
de cultures et d'ethnies. Les deux comparses y croisent beaucoup de gens
d'origines différentes comme des Chinois, des Allemands, des Français.
Cet hétéroclicité de boutiques, de restaurants et de cultures crée un
décor tout en couleur qui ne convient pas aux préjugés raciaux. "Ça fait
longtemps que je ne me suis pas sentie aussi bien. " En effet, dans un
milieu aussi hétérogène et pluriculturel, l'hybridité de Pitsémine perd
son aspect sacrilège pour devenir une caractéristique des plus banales.
Dans
ce milieu, les deux parties de la jeune femme peuvent se réconcilier sans
préjudice racial. Il n'y a donc rien de surprenant à ce qu'elle choisisse
d'y demeurer avec le minibus après le départ de Jack. "Elle voulait rester
un certain temps à San Francisco : elle pensait que cette ville, où les
races semblaient vivre en harmonie, était un bon endroit pour essayer
de faire l'unité et de se réconcilier avec elle-même. " À la fin du récit,
Pitsémine est sur la bonne voie pour trouver sa véritable identité à mi-chemin
entre les cultures québécoise et amérindienne. Je dois absolument mentionner
que la valorisation de l'hybridité est une particularité des textes postcoloniaux
s'accordant avec la promotion du mélange des cultures, des idées et la
confrontation des altérités. Ainsi, l'issue du récit prend, pour Pitsémine,
un tournant encourageant, permettant une forme de désaliénation personnelle.
La
dernière quête que j'analyse dans ce roman englobe la dimension sociale
du récit. Je traiterai de l'échec du grand rêve américain et de l'identité
québécoise en tant que dualité francité et américanité. Cette quête met
effectivement en valeur le caractère hybride de l'identité québécoise.
D'ailleurs, le grand rêve américain exerce sur Jack Waterman une fascination
particulière. L'Amérique! Chaque fois qu'il entendait prononcer ce mot,
Jack sentait bouger quelque chose au milieu des brumes qui obscurcissaient
son cerveau. […] Il pensait que, dans l'histoire de l'humanité, la découverte
de l'Amérique avait été la réalisation d'un vieux rêve. Les historiens
disaient que les découvreurs cherchaient des épices, de l'or, un passage
vers la Chine, mais Jack n'en croyait rien. Il prétendait que, depuis
le commencement du monde, les gens était malheureux parce qu'ils n'arrivaient
pas à retrouver le paradis terrestre. Ils avaient gardé dans leur tête
l'image d'un pays idéal et ils le cherchaient partout. Et lorsqu'ils avaient
trouvé l'Amérique, pour eux, c'était le vieux rêve qui se réalisait et
ils allaient être libres et heureux. Ils allaient éviter les erreurs du
passé. Ils allaient tout recommencer à neuf.
Comme
bien des rêves, le grand rêve de l'Amérique s'est soldé et se solde encore
par un cuisant échec. Le roman Volkswagen Blues raconte par le biais des
intertextes le rêve des premiers explorateurs et des premiers colons qui
ont gagné l'Oregon croyant y trouver une terre meilleure et une vie plus
douce. À l'image de leurs prédécesseurs, Théo, Jack et Pitsémine ont traversé
aussi le territoire espérant y trouver un monde agréable. Théo a été assimilé
par le territoire et y a perdu son identité originelle. Jack et Pitsémine
ont été déçus de l'accueil, des mœurs et pratiques des habitants de ce
monde bien idéalisé. Ils réalisent que leur rêve n'a rien à voir avec
la réalité.
Théo
a suivi le même parcours que ceux partis à la conquête d'une Amérique
libératrice. Sa dégradation physique et psychologique est également en
corrélation avec la dégradation de l'Amérique. Il a évolué selon le même
schème de déchéance personnelle et sociale. L'histoire américaine est
remplie de violence qui détruit l'illusion d'une terre où l'harmonie régnerait
toujours. Théo a commis des délits au cours de sa traversée du continent
et son frère est frappé par ses comportements criminels qui n'ont rien
à voir avec l'image qu'il s'était forgée de son frère.
Jack
choisit de retourner au Québec puisqu'il réalise que l'influence américaine
n'a pas que de bons côtés. S'il admet l'incidence de la culture américaine
sur sa propre identité culturelle, il refuse de lui accorder toute la
place au risque de perdre la qualité de son hybridité identitaire, un
mélange de la France, de l'Amérique et du Québec. En fait, si l'écrivain
québécois privilégie sa culture française au détriment de son américanité,
il risque de sacrifier l'intégrité de son identité personnelle et sociale
qui se situe à la jonction des deux mondes. En effet, le roman de Jacques
Poulin souligne une problématique culturelle du Québec qui demeure à l'intersection
entre une culture française séculaire et, me semble-t-il, l'énigme, voire
l'impasse d'une culture américaine.
Jack
Waterman, à un point tournant de sa vie, a besoin de connaître son appartenance
culturelle mais aussi littéraire qui influencera ses propres créations.
Il réalise qu'il subit l'influence des deux milieux. L'identité québécoise,
comme le disait si bien l'Auteur dans les Grandes Marées, est une histoire
d'entre deux. "Or, nous sommes des Français d'Amérique, ou des Américains
d'origine française, si vous aimez mieux. "
Cette
dualité identitaire est caractéristique des sociétés postcoloniales comme
le Québec. D'un point de vue historique, comme je le mentionne au premier
chapitre, le territoire québécois a subi deux régimes colonisateurs, le
régime français et le régime anglais une fois que le territoire fut cédé
à l'Angleterre. Le Québec, par sa grande concentration de francophone,
est longtemps demeuré majoritairement français et, naturellement, a entretenu
la culture de la France sans pourtant se fermer aux autres. Le Québec
a, d'autre part, subi l'influence de son voisin du sud, un des pays les
plus puissants du monde autant au plan politique, économique et artistique.
Le cinéma américain pénètre dans les foyers québécois depuis plusieurs
décennies déjà et fait connaître ses mœurs et sa mentalité. Cette influence,
cette confrontation à l'altérité américaine se révèle dans la littérature
québécoise. Il est en effet remarquable comme le mentionne Anne Marie
Miraglia que dans Volkswagen Blues, il y ait si peu d'intertextes d'écrits
français hormis certaine chanson comme Le temps des cerise ou une allusion
rapide au roman Fragiles Lumières de la terre de Gabrielle Roy. Ce roman
francophone montre donc l'ampleur de l'influence du corpus littéraire
américain sur la création de Poulin.
Le roman Volkswagen Blues est riche en éléments littéraires et sociaux.
Il comprend plusieurs caractéristiques structurelles soulignant le postcolonialisme
du texte. Jacques Poulin y utilise encore les mêmes procédés littéraires
que dans ses autres romans, soit l'intertextualité, la mise en abîme et
le métarécit à contenu majoritairement historique permettant une révision
du mythe américain. Cette révision de l'histoire si présente dans le récit
et dans l'élaboration du discours postcolonial est au centre même du roman
par la confrontation des deux altérités en présence, soit le Québécois
Jack et la métisse Pitsémine. Puis, il faut absolument souligner la présence
marquée du thème de la quête dans ce roman. Il y a de nombreuses quêtes
imbriquées les unes dans les autres qui naviguent sur la thématique plus
large de l'identité, une thématique reconnue comme récurrente dans les
textes postcoloniaux et qui, dans ce roman, s'ouvre vers la polyphonie
culturelle ou le pluriculturalisme.
L'analyse de ce dernier roman m'a permis de montrer toutes les facettes
et manifestations possibles du postcolonialisme dans un ouvrage contemporain.
Ce récit venait compléter avec justesse les éléments de compréhension
implantés et relevés dans le premier texte, Les Grandes Marées. Les deux
romans ont en commun plusieurs procédés littéraires et des thématiques
similaires, bien qu'ils soient développés différemment. De plus, ils permettent
de montrer l'importance de la figure de l'Autre dans la compréhension
et l'explication autant littéraire que sociale de la pensée postcoloniale.
En conclusion, j'établirai avec plus de précision toute l'importance de
la figure témoin du postcolonialisme littéraire, l'altérité, et montrerai
en quoi celle-ci délimite le postcolonialisme et le postmodernisme.
|